
|
Archives Virtuelles Latino-Américaines |
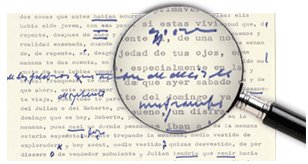
|
Le programme Archives Virtuelles Latino-Américaines
Les directeurs du Programme Archives Virtuelles Latino-Américaines nous convient à travailler sur la mémoire de l’inscription des sens d’une communauté continentale dans toutes ses facettes, en allant même jusqu’à reprendre les processus d’engendrement textuel: on parvient ainsi à récupérer un processus de production symbolique qui renoue avec les forces présentes dans la genèse et la structure d’un champ intellectuel.
La mémoire est un espace narratif qui n’est jamais ingénu et qui trace, déjà dans ses choix et dans ses registres, une voie vers l’interprétation. C’est dans ce sens que l’archivage interagit nécessairement avec la réflexion théorique à propos des documents historiques et culturels.
Même si le point de départ du Programme est le large patrimoine constitué par des fonds d’écrivains appartenant au CRLA-Archivos, un appel a été lancé pour y ajouter de nouveaux réservoirs documentaires et, en accord avec la volonté démontrée à maintes reprises d’aller au delà de “l’archive officielle”, on ne rejette pas les admissions plurielles, aussi bien en ce qui concerne le canon de la littérature latino-américaine (c’est à dire, le choix des textes et des autres documents) que pour ce qui est du canon critique qui interagit avec ce dernier. C’est bien pour cela que l’on parle “d’archives” au pluriel car on accepte d’emblée la pluralité et la diversité. Par ailleurs, on met en relief leur condition d’archives “virtuelles” dans la mesure où on utilise des ressources informatiques pour élargir la capacité de mise en mémoire et de traitement et pour éviter une « muséification » qui conserve et expulse en même temps.
Archiver et interpréter
Archiver et interpréter sont, en fait, des activités complémentaires: choisir, classer, ouvrir la possibilité de mettre en rapport, revient à fournir des propositions de lecture et cela constitue déjà un premier essai d’interprétation. Mais il s’agit surtout de propositions de lecture où l’on permet aux matériaux de parler par eux mêmes; c’est ce que l’on comprend par l’expression production de présence. Ce courant de paradigme indiciel –développé néanmoins en marge des postulats de Carlo Guinzburg–[1] a été travaillé en particulier par Hans Ulrich Gumbrecht, notamment dans Production of Presence: What Meaning Cannot Convey, [2] et reconnaît l’influence de la pensée de Jean-Luc Nancy, principalement à travers The Birth to Presence, publié en anglais par l’université de Standford il y a déjà 15 ans.[3]
“Production de présence” est un concept qui subsume tous les phénomènes et dimensions de la culture face auxquels on ne peut réagir convenablement par la simple projection d’un arsenal herméneutique. Dans la mesure où elle a été comprise comme l’attribution de sens, l’activité d’interprétation a été présentée comme l’aboutissement d’un processus de connaissance. Pourtant, une insistance trop poussée dans la théorisation herméneutique s’est exposée –dans la deuxième moitié du XIXe siècle– au danger de se séparer des réalités qu’elle interrogeait. Et de même qu’à la fin des années 1910 les formalistes russes ont éprouvé le besoin de fixer des limites à un exercice critique qui manquait souvent de fondement en proposant une méthode de description plus rigoureuse; à la fin des années 70 y au début des années 80, une réaction s’est produite contre l´hégémonie absolue du paradigme herméneutique dans les sciences humaines car celui-ci s’avérait trop permissif: l’herméneutique était devenue, selon Gianni Vattimo, un recours obligatoire, une sorte de nouvelle koiné au sein des Humanités. Comme contrepoids, on proposa alors la “pertinence”, c’est à dire, quelque chose qui pouvait faire l’objet d’une description et qui –du moment que la description était bien faite– allait clore l’attribution de sens différents; en d’autres termes, la méfiance quant à la possibilité de trouver des réponses définitives a porté à croire que – au moins– on pouvait essayer de trouver des pertinences, ce qui permettrait de surmonter les problèmes que posaient certains exercices herméneutiques. Plutôt que de prouver quelque chose, il s’agit alors de rendre compte de quelque chose. D’autre part, c’est une idée toute acceptée que lorsqu’on éprouve un certain mal être dans la culture des failles apparaissent qui font émerger la liberté que garde encore cette culture.
Mais il ne s’agit pas non plus de décréter la mort de l’herméneutique. Dans la lignée de la production de présence, l’existence d’une archive n’est pas uniquement un rappel de l’impossibilité de supposer que tout ce qui a été dit a été documenté, que tout ce qui a été documenté a ensuite été archivé et que tout ce qui a été archivé a été publié; l’existence d’une archive constitue la mise en jeu permanente d’une dialectique entre les effets de “présence” et les effets de “sens”.
Et, précisément, c’est par rapport à une dialectique de cette sorte que continue à se poser la question des limites –souvent poreuses– entre une discipline empirique et une science; autrement dit, entre une archivistique et une théorie de l’archive. D’autre part, la grande révolution technologique menée dans le domaine de l’informatique a conduit à redéfinir la conception même de science; en reprenant des paroles de Derrida: “En tant que techno-science, la science ne peut autre que devenir, par son mouvement même, une transformation des techniques d’archivage, d’impression, d’inscription, de reproduction, de formalisation, de chiffrement et de traduction de marques”.[4]
L’archive et la théorie de l’archive
L’archivistique était liée à ses débuts à la Diplomatique, à la Paléographie et à la Bibliothécologie; mais à partir du moment où elle fut considérée comme la discipline empirique chargée de la disposition et de l’organisation des archives, elle traversa trois stades différents: elle fut d’abord, au XIXe siècle, une science auxiliaire de l’Histoire, à l’heure où se développaient les sciences historiques et où l’on créait les écoles d’archivage; elle fut ensuite une science auxiliaire de l´administration, au moment des premiers grands changements socioéconomiques du début du XXe siècle; et, finalement, elle fut partie intégrante des Sciences de l’Information, dans une étape qui continue à se développer de nos jours.
Mais à partir de ses fonctions spécifiques et en accord avec l´évolution que les nouvelles technologies imposaient à l’archivistique, a surgit également une théorie de l’archive. Foucault, Derrida et Groys, en particulier, ont fait des contributions importantes dans ce domaine.
Dans l’Archéologie du savoir de Foucault,[5] l’archive n’est pas uniquement le système qui régit l’apparition des énoncés; c’est ce qui fait que toutes les choses dites ne s’amoncèlent pas indéfiniment en une multitude amorphe et qu’elles forment, en revanche, des ensembles de thèmes, de formes d’emploi et de registre, de rapports interconceptuels et des options ou des situations stratégiques qui organisent un savoir. De même, l’archive permet à ce qui est dit de ne pas s’inscrire dans une linéarité sans ruptures et, en même temps, de ne pas disparaître au hasard des accidents externes; bien au contraire: le dit s’unifie dans des figures distinctes qui se mettent en rapport sous des formes multiples, et qui se conservent ou disparaissent d’après des régularités spécifiques.
Derrida, de son côté, a déclenché dans Mal d’archive[6] un dialogue productif entre l’archivistique et la théorie psychanalytique, qui –parmi d’autres apports– l’a conduit à voir dans la psychanalyse une théorie de l’archive. Des concepts de base de la psychanalyse tels que registre, répression, censure ont dénoncé la présence d’un dehors au sein même de l’appareil psychique, ce qui entraîna l’hypothèse d’un support, d’une surface ou d’un espace internes sans lesquels il ne pourrait y avoir de consignation, de registre ou d’impression, ni de suppression, de censure ou de répression. Il proposa ainsi le concept d’une archive psychique différente de la mémoire spontanée et la théorie psychanalytique devint par cette voie une théorie de l’archive et pas seulement une théorie de la mémoire. Mais ce qui rend particulièrement intéressante cette idée c’est qu’elle permet d´établir un dialogue productif entre la théorie archivistique et les études littéraires et culturelles.
Plus récemment, dans un livre qui a pour titre On the new. Essay on cultural economy,[7] Boris Groys a redéfini le concept d’archive de Derrida pour découvrir un mécanisme d’innovation intrinsèque aux arts, un mécanisme qui, précisément, entraîne une friction formelle entre la réalité et le monde de l´art, permettant que l’un se glisse dans l’autre.
L’archive littéraire possède la même logique interne que le « musée » de Groys, une logique interne qui oblige les créateurs à s’introduire dans la réalité et qui fait en sorte que leurs représentations aient de la « présence », c’est à dire, qu’elles soient jugées « vivantes », ce qui revient à dire qu’elles soient « nouvelles ». L’archive littéraire en tant que constructrice de représentation historique ne reconnaît comme réel, présent et vivant que ce qui est nouveau; c’est pour cette raison que les répertoires consacrés sont très souvent taxés de « cimetières culturels » et que, paradoxalement, ils constituent le seul espace au sein duquel l’innovation est possible, dans la mesure où ils permettent d’introduire de nouvelles différences entre les choses. A l’intérieur de ces cadres théoriques s’ouvre alors un débat à propos de comment la production littéraire s’inscrit à l’intérieur du concept d’archive et cela oblige à revenir sur des aspects tels que la question des méthodes de classement avec ses jeux de décontextualisation et de recontextualisation et, très particulièrement, à mettre en relief l’établissement de nouveaux rapports entre les deux processus grâce à l’utilisation de nouvelles technologies.
La méthode et les outils. Les apports.
Quant à la méthode et aux outils utilisés pour la constitution d’une archive, il est vrai que le procédé de base pour l’incorporation de matériaux est, dans un premier temps, l’addition; mais une fois que l’on a créé une matrice, des plans de route et une carte (ouverte) de navigation, chaque nouveau parcours à travers le réseau des sentiers qui bifurquent –qu’est au fond toute archive– multiplie les possibilités de construire une mémoire collective en la recréant à chaque nouvelle trouvaille. Ainsi, les outils informatiques rendent plus facile la possibilité d’établir des liens qui relient le labyrinthe virtuellement infini de l’accumulation avec le marbre immobile de la mémoire monument et le transforment en une matière malléable qui rouvre incessamment le chemin de la connaissance, car il permet non seulement d’obtenir et de mettre en jeu de nouvelles données mais de réinterpréter et, en définitive, de découvrir et de créer.
D’autre part, l’existence d’un programme de cette nature, installé dans un Centre qui à son tour est lié à l’enseignement universitaire et à la recherche doctorale et post-doctorale multiplie encore plus l’éventail d’apports auxquels nous faisions référence, étant donné que ces apports contribuent à intégrer et à renforcer le travail sur les archives documentaires par rapport aux progrès des études historiques, littéraires et culturelles et, en même temps, ils facilitent ces progrès dans la mesure où ils convoquent des groupes divers avec leurs encadrements institutionnels respectifs. Cela permet d’encourager, par la même occasion, une incorporation régulière et soutenue de nouvelles ressources humaines (élèves, doctorants, jeunes chercheurs).
Ces archives virtuelles se sont ouvertes à un univers de sens qui en partie les met en contexte et en partie va au-delà d’elles; et avec cet horizon d’attentes elles ne peuvent se réduire exclusivement au patrimoine manuscrit –même si celui-ci en est la base–, ou se circonscrire à des dossiers génétiques stricto sensu. On inclut ainsi les pratiques d’écriture et de lecture parallèles (des réflexions sur l’écriture, des correspondances, des notes de lecture, des coupures de journaux, des fonds bibliographiques de l’auteur et des écritures du moi –c’est à dire, des journaux intimes, des mémoires, des autobiographies–). À ces matériaux –parfois publiés, parfois inédits– s’ajoutent les rayonnements postérieurs des textes: aussi bien les campagnes de réécriture des œuvres publiées par un même auteur que les dossiers de réception (et dans ce terrain il faut inclure aussi bien la production académique –comptes rendus de congrès, conférences, mémoires, thèses– que des articles de journaux). L’hétérogénéité des matériaux se déplace ainsi vers les supports et les modalités d’inscription: outre les manuscrits, les tapuscrits et les imprimés, on archive des dessins et d’autres représentations plastiques avec des enregistrements sonores, des vidéos, des films, etc. En somme, lorsqu’on projette une dimension trans-textuelle le relevé de données significatives ouvre la porte à tous les niveaux de sens avec lesquels est lié un itinéraire d’écriture (contextuels, prototextuels, textuels, post-textuels, paratextuels, intertertextuels, hypertextuels).
Dans ce type de groupements on peut percevoir aussi bien les tensions et les conflits que les stabilités précaires; c’est ainsi d’ailleurs que l’on évite de construire de nouvelles mythologies; et alors même qu’on analyse les formes de lecture et d’écriture qui ont été pratiquées, on se fraie de nouveaux chemins pour que des lectures nouvelles aient lieu à travers des reconnexions diverses.
Pour terminer, signalons que de la même façon que l’archive et la théorie de l’archive s’inscrivent dans la dynamique culturelle, la question de la dynamique culturelle embrasse ici l’objectif de sauvegarder un patrimoine littéraire continental. Il faut signaler alors que l’acte de recréation de la mémoire d’une communauté supranationale reprend les caractéristiques dont Renan fit la synthèse à l’image du « plébiscite quotidien », étant donné que cette représentation métaphorique de la mobilité de toute idée de Nation peut être appliquée au processus d’allers-retours participatifs qu’est au bout du compte toute construction culturelle identitaire.
Notas
[1] Ginzburg, Carlo, “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, en Gargani A. (edit.), Crisi de la ragione, Torino, Einaudi, 1979, pp. 59-106.
[2] Gumbrecht, Hans Ulrich: Production of Presence: What Meaning Cannot Convey, Stanford University Press, 2004.
[3] Nancy, Jean-Luc, The Birth to Presence, Stanford University Press, 1993.
[4] Derrida, Jacques, Mal de archivo. Una impresión freudiana, Madrid, Trotta, 1997, p. 22.
[5] Foucault, Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
[6] Derrida, Jacques, Mal d’archive. Une impression freudienne, Paris, Galilée, 1995.
[7] Groys, Boris, Sobre lo nuevo: ensayo de una economía cultural, Valencia, Pre-textos, 2005. [On the new. Essay on cultural economy, 1992.]