
|
Archives Virtuelles Latino-Américaines |
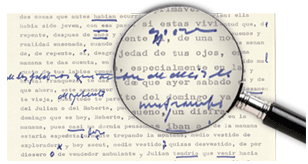
|
Avant que les participants à cette table ronde ne fassent une présentation détaillée des Archives Virtuelles Latino-Américaines,[1] je voudrais dire quelques mots en guise d’introduction générale à ce projet.
L’idée de créer un portail pour exposer ces Archives Virtuelles est née « naturellement », dans la continuité même de nos activités au sein du CRLA. D’un côté, notre centre, depuis sa fondation dans les années 60 et sous la houlette d’Alain Sicard, a défini parmi ses objectifs la constitution et la conservation des fonds littéraires latino-américains. L’accomplissement de ce dessein constitue encore un but important pour nous, et l’actuel directeur du CRLA, Fernando Moreno, mène une action efficace, pour détecter des archives d’écrivains, plus ou moins en perdition, et convaincre les ayants droits des bénéfices que les œuvres surgies de ces archives peuvent tirer d’un don ou d’un dépôt des documents pour étude, classement et conservation dans un centre universitaire comme le nôtre.
Pour ces tâches de sauvegarde du patrimoine textuel, l’un des atouts indéniables du CRLA, outre son intégration dans les réseaux intellectuels et académiques latino-américains, est le fait d’être hébergé par cette Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers, qui lui offre, non seulement un cadre approprié pour échanger au quotidien les réflexions et les expériences apparentées avec les représentants d’autres domaines des sciences humaines et sociales, mais aussi les moyens techniques et les infrastructures indispensables pour mener à bien la conservation, l’archivage et la communication des documents. Ces conditions optimales de travail font sans doute partie des arguments qui ont fondé la décision de l’Institut des Textes et des Manuscrits Modernes de nous associer étroitement dans un vaste programme de sauvegarde des manuscrits littéraires francophones, essentiellement d’Afrique et des Caraïbes, dont le centre des activités techniques et scientifiques sera organisé dans l’enceinte de cette maison.
À l’intérieur du CRLA, Sylvie Josserand et moi-même représentons l’une de ses composantes, l’équipe appelé « Archivos ». Pour nous, la numérisation et la mise en ligne des fonds littéraires s’inscrit clairement dans la ligne éditoriale et scientifique que nous menons depuis notre arrivée à Poitiers. La collection Archivos, dont nous sommes les responsables éditoriaux, a su, depuis vingt ans, mettre à l’abri les dossiers génétiques des grands classiques de la littérature latino-américaine contemporaine, pour la plupart dispersés, oubliés, maltraités, et mal établis en tant que textes d’éditions peu soigneuses. Les éditions Archivos ont accompli ainsi une double mission : une mission de sauvegarde, en rassemblant ces dossiers et en les mettant à la disposition de la communauté scientifique et en expérimentant dans ses livres différentes méthodes de registre et de transcription, et une mission de traitement et d’exploitation scientifique des documents.
C’est cette double mission que nous transférons aux Archives Virtuelles Latino-Américaines. Elle détermine les objectifs et les finalités du projet mais aussi, en même temps, la problématique qui guide nos discussions actuelles.
Une archive virtuelle, tout comme une archive traditionnelle, qui contient des documents sur papier ou sur parchemin, doit avant tout définir les meilleures conditions de conservation et de communication à long terme des documents. Cela pose des problèmes techniques assez complexes lorsqu’il s’agit de numériser et de mettre en ligne ces documents. La difficulté première découle de l’obsolescence prématurée (et préméditée) des systèmes et programmes informatiques, ainsi que des machines destinées à emmagasiner et à lire les données. Nombre de bases de données scientifiques, créées dans les vingt dernières années, sont aujourd’hui inexploitables, car les logiciels, les supports et les appareils utilisés pour leur réalisation ont été remplacés par les fabricants, qui ne cessent de lancer dans le marché des nouvelles versions et des nouvelles générations des produits.
Face à ce renouvellement vertigineux du parc informatique, la plupart des archives et des bibliothèques virtuelles publiques et privées ont pris la décision d’adopter des systèmes « ouverts », dont la licence, la structure et les accès appartiennent au domaine publique, pour échapper aux limitations et aux incompatibilités des systèmes « propriétaires ». Néanmoins, cette adoption ne règle pas tous les problèmes de longévité de ces bases : la fragilité intrinsèque des supports informatiques génère, si l’on ne met pas en œuvre des garde-fous parfois assez coûteux, des risques de détérioration ou de disparition des données. N’oublions pas que, à la différence d’une édition traditionnelle qui, en multipliant les exemplaires - dont un bon nombre seront entreposés dans des centres de conservation -, garantit dans une large mesure la sauvegarde du document originel, une édition numérique ouvre de multiples accès pour une version unique du document déposée sur un serveur, c’est-à-dire, sur un disque dur, périssable et fragile.
L’installation de documents sur le réseau virtuel permet à l’usager, au chercheur, de bénéficier, pour l’analyse de ces documents, de multiples fonctions informatiques : outils de détection, statistique et concordance lexicale, outils de consultation hypertextuelle, outils de création automatique d’index thématiques, etc. Ce vaste éventail de possibilités de réagencement et de manipulation des données pose aussi des problèmes et exige une réflexion non seulement sur le plan technique (technologique) mais aussi sur le plan scientifique, théorique, et même juridique et moral.
Sur le plan technique, le choix le plus élémentaire est celui du mode de reproduction des documents. Doit-on offrir à l’usager une reproduction photographique des documents ou une transcription typographique ? Dans ce type de décision, l’un des critères non négligeables qui doit entrer en ligne de compte est la disponibilité réelle de temps-travail, c’est-à-dire, en dernière instance, le critère financier. On sait, par exemple, qu’une des bibliothèques virtuelles les plus importantes d’Europe, Gallica, a mis en ligne la plus grande partie des fonds numérisés de la Bibliothèque Nationale de France, en mode « image », considérant que le traitement OCR et les corrections orthographiques des textes représentaient un coût trop élevé, au vu du nombre important de documents à traiter. Cette option est au centre du projet éditorial d’une collection virtuelle d’ouvrages, étant donnée que les readers et autres consoles portables qui commencent à s’imposer sur le marché comme supports de l’e-Book, ne peuvent en général mettre en œuvre leurs fonctionnalités que si les documents sont offerts en mode « texte ».
Dans le cas dans d’une collection aux dimensions somme toutes modestes comme la nôtre, les obstacles financiers peuvent être franchis avec un peu plus de facilité (grâce surtout à la générosité des étudiants et des doctorants qui participent plus ou moins bénévolement au projet). Mais notre collection est composée de textes et de documents qui relèvent exclusivement des archives littéraires, ce qui fait ressurgir le problème sous un autre angle.
En effet, un manuscrit d’auteur parle autant par ce que dit son texte que par la topographie de la page ; le jeu des ratures, substitutions et ajouts montre le processus de gestation du texte et le bonifie avec des significations complémentaires, l’illumine avec une lumière neuve, différente, enrichissante. Pour mettre en valeur cet apport des documents d’archive à la connaissance de l’œuvre, pour permettre au chercheur de les lire dans tous les sens, dans toutes les directions qu’a emprunté le mouvement de création, il faut les donner à voir dans leur état originel, ce qui veut dire, les reproduire en mode image. Mais en agissant de la sorte, je le répète, on neutralise tous les outils que l’informatique met à disposition du lecteur pour effectuer des recherches lexicales et autres, à l’intérieur du document.
La démarche la plus appropriée serait, peut-être, d’offrir en parallèle, la reproduction photographique de chaque page manuscrite avec sa transcription. Mais cette démarche entraîne un nouveau problème : c'est que transcrire un document manuscrit est une tâche lente et difficile, qui exige une formation et une pratique préalables ; transcrire, c’est savoir lire, interpréter et réécrire non seulement le contenu de chaque document mais aussi les différentes opérations d’écriture et de correction, les différentes phases de l’élaboration. La transcription d’un fonds volumineux comme notre Fonds Carlos Droguett, par exemple, exigerait un travail de longue haleine d’une équipe de spécialistes, ce qui, de toute évidence, est hors de portée d’un petit laboratoire universitaire comme le CRLA.
Par ailleurs, beaucoup de spécialistes considèrent que ce n’est pas la fonction d’une archive de manuscrits, même virtuelle, que de proposer une transcription des documents. La transcription est un acte d’édition qui comporte beaucoup de partis pris, et même si on explicite les arguments qui justifient chaque choix, chaque option, elle relèvera toujours de l’interprétation. Dans la perspective de la génétique textuelle, la transcription fait partie de l’ensemble de démarches qui composent l’analyse du processus de création de l’œuvre et c’est à chaque chercheur d’organiser les étapes de son travail scientifique en conformité avec ses propres principes méthodologiques.
Il faut considérer aussi que si la transcription d’un manuscrit et sa mise en ligne est un acte d’édition, il y a des problèmes juridiques qui entrent en ligne de compte, surtout quand le fonds littéraire est constitué d’un grand nombre d’inédits –c’est le cas de nos Fonds Carlos Droguett et Rufino Blancofombona, et aussi, dans une certaine mesure, du Fonds Cortazar et des cahiers de la prison d’Alicia Kozameh. Pour les ayants-droits de ces fonds, ce n’est pas la même chose d’autoriser la reproduction photographique des manuscrits, et de les voir transcrits, c’est-à-dire, transformés en textes et mis librement à la disposition du lecteur, qui peut ainsi non seulement reproduire à volonté l’œuvre, mais aussi la modifier, la dénaturer.
Voilà quelques-unes des questions qui occupent nos discussions actuelles et qui nous obligent à réfléchir, dans cette phase qui voit se conclure le travail de numérisation et d’organisation dans une base de données des documents qui constituent le fonds littéraire Carlos Droguett, aux meilleurs moyens d’offrir à la communauté scientifique, non seulement un ensemble de documents autographes de création jusque là inaccessibles et méconnus, mais aussi des outils qui rendent plus simples et efficaces les opérations visant leur étude et interprétation. Nous voudrions associer à cette discussion tous nos amis et partenaires qui dans cette MSHS de Poitiers, dans notre laboratoire de tutelle et dans nos réseaux de latino-américanistes des deux côtés de l’Atlantique, nous ont toujours soutenus et éclairés.